Newsletter trimestrielle n°30
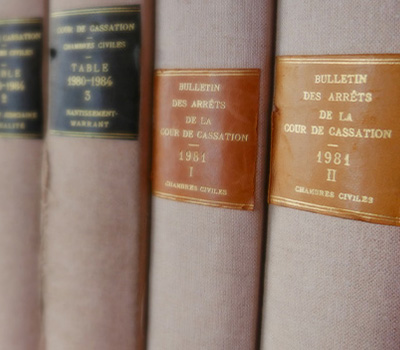
Cette troisième newsletter de l’année 2025 revient sur les arrêts importants obtenus par le cabinet depuis le mois d’avril.
C’est la dernière newsletter avant les vacances judiciaires de l’été.
Le cabinet a obtenu des arrêts de principe dans des matières variées (droit des procédures collectives, droit des sociétés, droit du travail, procédure civile, droit fiscal…).
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au Recueil Lebon.
Bonne lecture ! et bel été !
Droit Commercial
Procédures collectives – Arrêt des poursuites individuelles – Interruption des instances en cours – Domaine d’application – Exclusion – Instance en référé-provision – Portée
Com., 2 juillet 2025, n°24-17.279
Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle une solution jurisprudentielle constante mais encore méconnue par les juges du fond.
Elle rappelle ainsi que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de [l’article L. 622-22 du code de commerce] ».
En effet, selon une jurisprudence constante, « l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance » et que « tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire » (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, B 123 ; Com., 19 septembre 2018, pourvoi n°17-13.210, B 100 ; Civ. 3, 30 mai 2024, pourvoi n° 22-24.326).
Elle en déduit que lorsqu’une société condamnée au paiement d’une provision est mise en procédure collective en cours d’appel, la cour d’appel « doit infirmer l’ordonnance [l’ayant condamnée en première instance] et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par [l’article L. 622-21 du code de commerce ».
La cour d’appel ne peut donc ni condamner le débiteur placé en redressement judiciaire au paiement d’une provision ni même fixer la créance au passif.
Privée du pouvoir de statuer sur la créance par l’effet de la procédure collective, elle doit, au besoin, d’office, relever l’irrecevabilité de la demande.
Société – action ut singuli- irrecevabilité
Com, 9 juillet 2025, n°24-14.565, publié au bulletin
Cette affaire est l’occasion pour la Chambre commerciale de juger dans un arrêt publié au bulletin que l’action ut singuli ne peut être dirigée contre le liquidateur amiable d’une société anonyme.
L’article L 225-252 du code de commerce, applicable en matière de société anonyme, dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
Cette disposition est une application de la règle posée, de manière générale, par l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil selon lequel « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
Ainsi, l’action ut singuli est exercée à l’encontre d’un dirigeant.
La Cour de cassation a jugé, sur ce point, qu’une telle action n’était pas recevable à l’encontre d’un liquidateur amiable (voir Com, 21 juin 2016, n°14-26.370).
Dès lors, selon la jurisprudence, les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce n’autorisent les associés à exercer l’action sociale en responsabilité que contre des gérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Com, 6 décembre 2017, n°16-21.005 ; Civ 3 ème, 5 décembre 2019, n°18-26.102, B).
Ces principes doivent s’appliquer, de la même manière, dans le cadre d’une société anonyme.
C’est ce qu’a jugé dans son arrêt du 9 juillet 2025 la Chambre commerciale.
Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article R. 225-170 du code de commerce que l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action ut singuli engagée contre le liquidateur amiable de la société, et non contre la société elle-même.
Procédure Civile
Défaut de comparution d’une partie – Office du juge – diligences de l’huissier
Civ 2ème, 7 mai 2025, n°23-15.407
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les exigences de motivation précises qui s’imposent aux juges du fond en cas de défaut de comparution d’une partie citée à comparaitre.
Elle juge ainsi qu’il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
Elle censure, par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer comme il l’avait fait, avait relevé d’une part, que la partie n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, d’autre part, que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant lui avaient été signifiées selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile sans vérifier que la citation délivrée par procès-verbal au dernier domicile connu comportait les mentions exigées par les articles 655 à 659 du code de procédure civile.
Autorité de chose jugée – Portée – procédures de saisie successives
Civ 2ème, 22 mai 2025, n°22-21.157
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que l’autorité de chose jugée d’une décision rendue dans une première procédure de saisie ne peut faire obstacle à ce qu’une partie invoque, dans le cadre d’une seconde procédure de saisie, un moyen de défense qu’elle n’avait pas invoqué dans le cadre de la précédente procédure visant le même bien immobilier.
Elle censure par conséquent, le raisonnement contraire retenu par les juges du fond en rappelant qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité et que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Appel civil – Appelant – Conclusions – Dispositif – Appelant n’ayant conclu ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement – Portée
2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-23.482
Par cet arrêt, la Cour de cassation a réaffirmé sa solution déjà consacrée tendant à juger que l’appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel (v° récemment, Com. 6 mars 2024, n° 22-13.484 ; 2ème civ. 23 mai 2024, n° 22-15.408 ; 4 juillet 2024, n° 22-18.143 ; Soc. 11 septembre 2024, n°s 22-17.997, 22-17.998, 22-17.999 et 22-18.000 (quatre arrêts)).
Elle a rappelé à cette occasion qu’il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, qu’à défaut, en application de l’article 908 du même code, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, de sorte que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’ infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Elle a également rappelé que cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2ème civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, B), que faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, a été différée aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, dès lors qu’elle aboutissait à priver les appelants du droit à un procès équitable, et qu’ainsi reportée dans le temps, l’application de cette règle devenue prévisible, dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice et qui poursuit le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, ne constitue pas une charge procédurale excessive par le formalisme qu’elle implique, sa sanction n’étant en outre pas disproportionnée, de sorte qu’elle ne porte aucune atteinte au droit d’accès au juge.
Ainsi, juge la 2ème chambre civile, la cour d’appel, qui relève, par motifs propres et adoptés, que le dispositif des premières conclusions des appelants, transmises le 28 septembre 2021, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, pas plus que d’annulation, de sorte que l’objet du litige ne peut être déterminé au regard de l’article 542 du même code, en a déduit à bon droit que la déclaration d’appel était caduque.
Droit du Travail
Licenciement – lettre de licenciement – pouvoir du signataire – association – statuts
Soc. 6 mai 2025, n° 23-21.409
Dans cette affaire, la Cour de cassation a réaffirmé sa solution consacrée tendant à juger que si le salarié d’une association peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur de l’association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir (Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.781, B).
Elle a rappelé à cette occasion qu’il résulte des dispositions des articles L. 1232-6 du code du travail et 1200 du code civil que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.
Ainsi, selon la Chambre sociale, viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que les statuts de l’association ont été modifiés le 29 juin 2018, que les nouveaux statuts, applicables immédiatement, prévoient le renouvellement du conseil d’administration par tiers tous les deux ans, que ce conseil comporte 12 membres, et qu’il élit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président, et ajoute que le dernier conseil d’administration a été élu le 29 juin 2018 et comportait 11 membres, ce dont elle déduit que si M. X a été élu président le 10 juillet 2018, c’est donc par un conseil d’administration qui ne respectait pas les statuts, prévoyant 12 membres et non seulement 11, de sorte que M.X , signataire de la lettre de licenciement, n’avait pas le pouvoir de prononcer la rupture du contrat de travail.
Droit Public
Introduction de l’instance – Délais – interruption par un recours administratif adressé par voie postale – Date à prendre en considération – Date d’expédition
CE, 30 juin 2025, req. n° 494.573, publié au recueil Lebon
Dans un arrêt de Section rendu le 13 mai 2024, le Conseil d’Etat avait remis en cause une jurisprudence séculaire pour considérer que désormais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
A ainsi été abandonnée la jurisprudence classique en vertu de laquelle, sauf délai d’acheminement postal anormalement long, c’est la date de réception par la juridiction qui était prise en considération.
Par le présent arrêt et comme on pouvait s’y attendre, le Conseil d’Etat a décidé d’étendre sa nouvelle jurisprudence au cas des recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques.
Désormais, pour apprécier si ceux-ci prorogent le délai de recours contentieux, il faut donc prendre en considération leur date d’expédition et non plus leur date de réception.
Elections – Démission d’office consécutive à une condamnation à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire – Nouvelle-Calédonie
CE, QPC, 26 juin 2025, req. n° 499.627
En vertu du III de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire doit être considérée comme justifiant une décision du Haut-commissaire de la République prononçant la démission d’office de l’élu de Nouvelle-Calédonie de l’ensemble de ses mandats, quand bien même la condamnation ne serait pas définitive.
Dans le cadre d’un recours contre une telle décision intervenue dans ces circonstances, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée tendant à faire valoir que ce texte méconnaissait le principe d’égalité devant la loi notamment en ce que les élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie subissaient un sort différent des parlementaires de métropoles, lesquels ne peuvent être privés de leur mandat tant que la condamnation à une peine d’inéligibilité, même assortie de l’exécution provisoire, n’est pas définitive.
En effet, la récente décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 (n° 2025-1129 QPC) avait considéré que les élus locaux métropolitains qui ne bénéficient pas de cette protection ne subissaient aucune rupture d’égalité dès lors que les parlementaires ne sont pas placés dans la même situation, ceux-ci exerçant la souveraineté de la Nation en votant les lois, contrôlant l’action du gouvernement qu’ils peuvent censurer et en votant le budget de l’Etat. Cette différence de situation justifiait la différence de traitement.
Or la Nouvelle-Calédonie exerce une souveraineté partagée avec la métropole et sur les compétences relevant de la Nouvelle-Calédonie, les membres du congrès votent le budget, les actes nommés « lois du pays » qui ont valeur de loi et peuvent engager la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, comme le font les parlementaires.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a d’abord considéré que la récente décision du Conseil constitutionnel constituait un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la constitutionnalité de la loi organique du 19 mars 1999 qui, comme toute loi organique, avait déjà été examinée par le Conseil constitutionnel.
Il a, en outre, considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité était sérieux.
La QPC a, en conséquence, été renvoyée au Conseil constitutionnel.
Droit Fiscal
Revenus de capitaux mobiliers – Revenus distribués – Revenus de source étrangère – répartition faites aux associés (article 120 3° du CGI) – Sommes distribués au maître de l’affaire ou à l’ayant droit économique – Exclusion
CE, 9 mai 2025, req. n° 496.088, mentionné aux tables du recueil Lebon
L’article 120 du code général des impôts dispose que « sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ; (…) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission ».
Une cour administrative d’appel a approuvé l’administration fiscale d’avoir soumis un contribuable à des suppléments d’impôt sur le revenu en application de ce texte en relevant qu’il était le maître de l’affaire de la société distributrice étrangère et devait donc être considéré comme le bénéficiaire des revenus de source étrangère litigieux.
Le Conseil d’Etat censure cette analyse puisque le contribuable n’avait pas la qualité d’associé ou de porteur de parts, comme l’exige le texte, de sorte que sa qualité de maître de l’affaire ou d’ayant droit économique était une circonstance inopérante.
Le juge impose donc une lecture stricte du texte sur la qualité du bénéficiaire, sans possibilité d’extension.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a appliqué au 3° de l’article 120 du code général des impôts, la position qu’il avait adoptée à l’égard du 2° de l’article 109 (CE, 29 juin 2020, M. Giraud, req. n° 433.827).
