Newsletter trimestrielle n°31
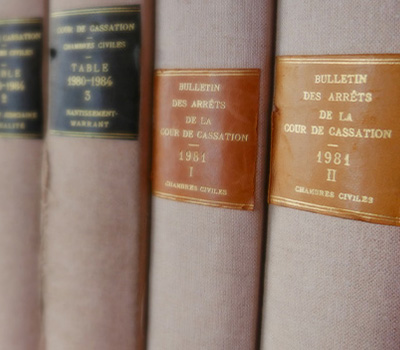
La dernière newsletter de l’année 2025 revient sur les arrêts importants obtenus par le cabinet depuis l’été dernier et, en particulier, depuis la rentrée judiciaire.
Le cabinet a obtenu des arrêts de principe dans des matières variées (bail commercial, garantie décennale, successions, procédure civile, fonction publique, droit fiscal…).
Cette newsletter met, plus particulièrement, en lumière certains de ces arrêts dont la plupart sont publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation ou au Recueil Lebon.
Bonne lecture !
Droit Privé
Bail commercial- Preneur – Obligations – Paiement des loyers – Exception – Exception d’inexécution – Conditions – Détermination
Civ.3ème, 18 septembre 2025, n°23-24005, publié au bulletin
Par cet arrêt de principe, la troisième Chambre civile juge que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable.
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de reconnaitre, en matière de bail commercial, l’exercice de l’exception d’inexécution dès lors que les agissements du bailleur rendent les lieux impropres à l’usage auquel ils sont destinés (Civ.3, 25 juin 2003, n° 01-15.364 ; 10 janvier 2009, n° 07-20.316 ; 6 juillet 2023, n° 22-15.923).
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’impossibilité de jouir des lieux ou du fait que les manquements du bailleur les rendent les lieux impropres à l’usage auquel ils sont destinés (Civ.3, 6 juillet 2023, n° 22-15.923)
Ces décisions n’évoquaient pas de mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution.
En outre, la mise en demeure ne s’impose donc pas d’elle-même au créancier pour répondre à une inexécution de ses obligations par son cocontractant.
La Cour de cassation, statuant en chambre mixte, avait eu l’occasion de rejeter le pourvoi faisant grief à l’arrêt de dire que « les termes du contrat n’impliquent nullement une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure » et de la condamner à payer 15 000 euros à la société Deli K Star, malgré l’absence de mise en demeure (Chambre mixte 6 juillet 2007, n° 06-13.823).
Par cet arrêt de principe publié au bulletin, du 18 septembre dernier, la Cour de cassation affirme que le preneur à bail peut se prévaloir de l’exception d’inexécution sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable au bailleur dont les manquements rendent les locaux impropres à l’usage auxquels ils sont destinés.
Entrepreneur – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garantie décennale – Construction d’un ouvrage – Définition
Civ. 3ème, 25 septembre 2025, n°23-18.563, publié au bulletin
Cet arrêt a été l’occasion pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation de préciser le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs en cas de travaux réalisés sur un ouvrage existant et de définir, en creux, le champ d’application de l’article 1792-7 du code civil qui exclut l’application de la garantie décennale pour les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle.
L’affaire portait sur le régime applicable à des travaux de rénovation d’un revêtement réfractaire des composants d’une unité de production d’ammoniaque.
Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de les avoir soumis à la garantie décennale et d’avoir refusé d’appliquer l’article 1792-7 du code civil écartant cette garantie.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a approuvé la qualification retenue par les juges du fond.
Elle a d’abord souligné que la cour d’appel avait relevé que l’entrepreneur « avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l’intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles ».
Puis elle a jugé que dès lors que la cour d’appel avait « retenu [par ces motifs] que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, elle en a[vait] exactement déduit qu’ils ne relevaient pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du même code ».
Autrement dit, la Cour de cassation juge que dès lors que des travaux peuvent être qualifiés en eux-mêmes d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ils sont soumis à la garantie décennale, quel que soit l’objet sur lequel ils ont été réalisés.
Le fait qu’ils aient été ou non effectués sur un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle est à cet égard indifférent.
Succession – Indivision – Partage – Attribution préférentielle
Civ.1ère, 1er octobre 2025, n°23-16618
Cet arrêt inédit n’en reste pas moins important quant à l’application 832-3 du code civil.
Selon ce texte, « L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. »
La Cour de cassation vient rappeler les pouvoirs du juge en cas de demandes concurrentes d’attribution préférentielle.
Elle précise ainsi qu’en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir tout en soulignant que cette disposition implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants.
Elle censure dès lors les juges du fond qui, pour apprécier l’aptitude des postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir, avaient pris en considération leur descendance et non leur propre personne.
Mandat exclusif en matière immobilière – respect de la loi des parties
Civ 3ème, 10 juillet 2025, n°23-23.698
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ce qu’il faut entendre par l’expression claire et précise d’un mandat immobilier « donné à titre exclusif pour toute la durée définie [au contrat] ».
Elle rappelle que, par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Elle censure, par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire qu’un mandant n’avait commis aucune violation de la clause d’exclusivité précitée du mandat immobilier confié à un avocat, avait retenu que si le mandant avait signé avec une agence immobilière un mandat ayant le même objet et la même finalité que celui confié à l’avocat, alors que celui-ci, encore actif, était exclusif en vue de la réalisation de la vente, il n’était pas démontrée que la vente intervenue par l’intermédiaire de cette agence immobilière dans les six mois de la résiliation du mandat confié à l’avocat a, en outre, été faite au profit d’un acquéreur présenté par ce dernier.
Ainsi, selon la troisième Chambre civile, la cour d’appel a ajouté une condition à la condition d’exclusivité que le mandat ne prévoyait pas durant sa période de validité.
Procédure Civile
Cassation civile – Outre-mer – Nouvelle-Calédonie – Prescription civile – Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Point de départ – Connaissance des faits permettant l’exercice de l’action – Cas – Action récursoire – Date de la signification par le greffe de la requête du demandeur à l’action principale – Portée
Civ.3ème, 11 septembre 2025, n° 23-22.555, publié au bulletin
Dans cette affaire, la Cour de cassation a mis en œuvre, au cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, les principes découlant de ses arrêts de chambre mixte du 19 juillet 2024 (pourvoi n°20-23.527, publié au Bulletin et pourvoi n°22-18.729, publié au Bulletin.
Ainsi, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
Selon l’article 54-3-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les requêtes sont signifiées aux parties intéressées à la diligence du greffier dans les vingt-quatre heures du dépôt ou de la régularisation, cette signification faisant courir les délais.
Selon l’article 757 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur saisit le tribunal par requête remise au greffe, cette remise fixant la date de saisine de la juridiction.
Il en découle qu’en droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, la prescription du recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ la date à laquelle lui a été signifiée par le greffe la requête du demandeur à l’action principale et ce délai est interrompu par la remise au greffe de sa requête à l’encontre de ce tiers, laquelle saisit la juridiction de son action récursoire.
Par suite, a donc été censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa qui a retenu que l’action récursoire était prescrite alors qu’elle relevait que l’intéressé avait saisi le tribunal de première instance, moins de cinq ans après la signification de la requête du syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Droit du Travail
Licenciement – lettre de licenciement – pouvoir du signataire – association – statuts
Soc. 6 mai 2025, n° 23-21.409
Dans cette affaire, la Cour de cassation a réaffirmé sa solution consacrée tendant à juger que si le salarié d’une association peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur de l’association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir (Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.781, B).
Elle a rappelé à cette occasion qu’il résulte des dispositions des articles L. 1232-6 du code du travail et 1200 du code civil que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.
Ainsi, selon la Chambre sociale, viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que les statuts de l’association ont été modifiés le 29 juin 2018, que les nouveaux statuts, applicables immédiatement, prévoient le renouvellement du conseil d’administration par tiers tous les deux ans, que ce conseil comporte 12 membres, et qu’il élit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président, et ajoute que le dernier conseil d’administration a été élu le 29 juin 2018 et comportait 11 membres, ce dont elle déduit que si M. X a été élu président le 10 juillet 2018, c’est donc par un conseil d’administration qui ne respectait pas les statuts, prévoyant 12 membres et non seulement 11, de sorte que M.X , signataire de la lettre de licenciement, n’avait pas le pouvoir de prononcer la rupture du contrat de travail.
Droit Public
Fonction publique – Mise à la retraite d’office pour invalidité – avis de la commission de réforme – Délai de dix jours permettant au fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier – Garantie pour l’agent
CE, 26 septembre 2025, req. n° 488.244, mentionné aux tables du recueil Lebon
L’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis./ Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical ».
Son article 16 de cet arrêté indique encore que « […] Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ».
Les délais figurant dans ces deux textes constituent des garanties pour l’agent au sens de la jurisprudence Danthony.
S’agissant du délai de convocation de quinze jours, le vice peut rester sans incidence si l’agent a été effectivement présent à la séance de la commission.
Cependant, et c’est l’apport de cet arrêt du Conseil d’Etat, le délai de dix jours de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de cette commission.
Droit Fiscal
TVA – Liquidation de la taxe – Déductions è Remboursement de la taxe – TVA facturée à tort – Modalités de régularisation
CE, 22 juillet 2025, Société Eurapack, req. n° 494.230, publié au recueil Lebon
En principe, la TVA figurant sur une facture doit être reversée au Trésor par l’émetteur de la facture, même si elle a été mentionnée à tort, dès lors qu’elle peut donner lieu à déduction de la part de son client.
Le droit de l’Union européenne exige cependant, en vertu du principe de neutralité, que les Etats membres prévoient dans leur ordre juridique les conditions d’une régularisation.
A défaut de texte de droit interne, le Conseil d’Etat a procédé à la définition de ces conditions dans cet arrêt qui sera publié au recueil Lebon.
Le redevable ayant facturé à tort la TVA sur une facture émise peut donc être dispensé de la reverser au Trésor dans deux cas :
– soit le risque de perte de recettes fiscales est inexistant (destinataire non assujetti à la TVA insusceptible de la déduire) ou a été éliminé (refus de déduction opposé en temps utile et de manière définitive par l’administration au destinataire).
Dans ce cas, il ne suffit pas que le redevable qui a émis la facture ait entrepris tout ce qu’il pouvait pour que son client renonce à la déduction ni qu’il ait averti l’administration, même en temps utile pour procéder à une rectification du destinataire qui aurait déduit la taxe (v. l’arrêt du même jour n° 472,910).
Le Conseil d’Etat adopte une position assez stricte et exige un constat d’élimination effective du risque de perte de recettes fiscales.
– soit, à défaut, l’émetteur de la facture est de bonne foi et a adressé à son client une facture rectifiée.
L’émetteur qui aura donc accompli tout ce qu’il pouvait pour régulariser la situation, même vainement, pourra bénéficier d’une régularisation et sera dispensé de reverser la TVA.
Le Conseil d’Etat pose ainsi une règle claire d’équilibre entre une appréciation stricte de la notion d’élimination du risque de perte de recettes fiscales et plus souple sur la bonne foi.
Dans le cas d’espèce, la cour avait considéré que la société n’avait pas éliminé le risque de perte de recettes fiscales même si elle avait adressé des factures rectificatives et averti l’administration, ce que la Conseil d’Etat a validé.
Elle a cependant considéré qu’à défaut d’élimination du risque, la bonne foi de la société ayant émis la facture était inopérante.
C’est ce que le juge de cassation censure puisque la bonne foi devient, dans ce cas, déterminante.
